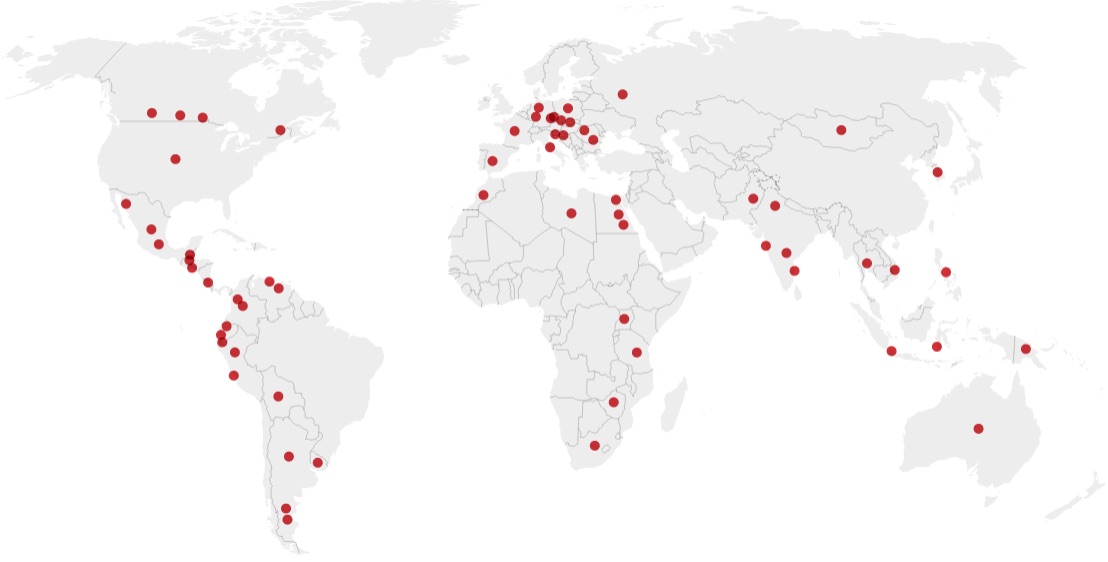13 juin 2023

Le colonialisme, aux racines des accords de libre-échange : la domination des régimes juridiques occidentaux (partie 2/3)
par bilaterals.org
Cette série en trois articles présente une lecture historique des accords de libre-échange et des traités bilatéraux d’investissement. Elle soutient que le colonialisme se trouve à la racine même de l’idéologie du libre marché et des lois qui ont régi le commerce international au cours des trente dernières années. Les relations de pouvoir héritées de l’ère coloniale ont établi les fondements du commerce international moderne. Une analyse approfondie de la nature de ces accords est essentielle pour apporter des réponses aux problèmes qu’ils engendrent. La première partie explore le développement du commerce international à l’aube du colonialisme. La deuxième partie montre comment les États et les entreprises coloniaux ont façonné les règles du commerce international et de l’investissement. Enfin, la troisième partie examine la manière dont les pratiques actuelles de libre-échange reflètent leur héritage colonial.
Points clés :
- L’Europe a établi sa domination politique et commerciale grâce à la conquête de territoires étrangers.
- Les entreprises coloniales ont consolidé leur influence en obtenant des droits souverains et des privilèges qui mêlaient commerce, guerre et droit international.
- Le colonialisme a engendré l’imposition d’un régime juridique de commerce et d’investissement favorable aux Européens.
- Le droit international de l’investissement qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale est l’héritage des doctrines élaborées à l’époque coloniale.
Comme l’illustre la première partie, le développement du commerce international n’a rien eu de « naturel ». Au contraire, les États, sous l’influence de marchands capitalistes, l’ont délibérément encouragé à la fin du Moyen Âge. L’alliance entre les États et les marchands leur a permis de tirer profit des nouvelles conquêtes territoriales et d’asseoir leur domination.
Les « nouveaux mondes »
À partir des XVe et XVIe siècles, les conquêtes européennes ont conduit à l’affirmation de la suprématie politique et commerciale du continent. Ces conquêtes ont été suivies de l’établissement d’un cadre juridique international favorable aux colonisateurs, leur octroyant des pouvoirs étendus et érigeant de nouvelles règles commerciales et d’investissement dans les territoires conquis [1].
L’Empire espagnol, en pleine expansion, a été le précurseur de cette entreprise en s’emparant des terres qui correspondent aujourd’hui aux Amériques. Dès le départ, le commerce se trouvait au cœur des enjeux. Les envahisseurs étaient à la recherche de l’or, de l’argent et des autres richesses de la région. Armés, porteurs de maladies et animés par le christianisme, ils ont également débarqué avec des notions occidentales de « liberté de commerce ». Francisco de Vitoria, juriste espagnol, soutenait que les conquistadors avaient le droit de voyager et de commercer librement avec les populations locales. Ainsi, les actes de résistance pouvaient être « légalement » interprétés comme une violation de ce droit autoproclamé des envahisseurs. Selon les Espagnols, la guerre, le pillage et la dépossession étaient donc pleinement justifiés, et souvent accompagnés d’énormes brutalités [2]. Par la suite, les théories de Vitoria ont influencé l’élaboration de doctrines juridiques internationales favorables aux entreprises coloniales. D’autres juristes ont repris nombre de ces idées lorsqu’ils ont été confrontés à des situations similaires dans d’autres colonies [3].
En réalité, ce sont pas les États qui ont été les principaux moteurs du colonialisme, mais les grandes sociétés, telles que la Compagnie (anglaise) des Indes orientales, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les administrations impériales n’ont été mises en place que plus d’un siècle après l’arrivée de ces compagnies coloniales, une période suffisamment longue pour influencer l’émergence du droit international [4].
Hugo Grotius (1583-1645), considéré comme le père du droit international, travaillait comme avocat pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, quand il préconisa la « liberté des mers ». Il voulait ainsi conférer une valeur juridique aux actions de la compagnie qui visaient à briser le monopole du commerce maritime détenu par ses concurrents étrangers. C’est en vertu de ce principe que la compagnie néerlandaise s’est emparée du navire de commerce portugais, le Santa Catarina, et en a confisqué l’ensemble de la cargaison. En d’autres termes, des doctrines juridiques favorables aux intérêts de la compagnie, inventées par son propre juriste, ont légitimé sa conduite agressive.
Les États ont également accordé des pouvoirs souverains et des privilèges aux grandes compagnies coloniales, afin qu’elles puissent exercer leurs activités dans les territoires conquis. Par exemple, la Compagnie royale (anglaise) d’Afrique détenait le monopole du commerce dans les territoires africains de l’Empire britannique. Elle pouvait ainsi construire des forts, entretenir une armée et négocier la guerre ou la paix avec les populations indigènes païennes [5]. La Compagnie (anglaise) des Indes orientales avait le droit de conquérir et d’administrer des territoires, de réprimer les rébellions des populations locales et de prélever des taxes pour soutenir son commerce d’esclaves et de minéraux, sans avoir à rendre de comptes [6]. De même, aux Amériques, la Compagnie de la Nouvelle-France, et surtout la Compagnie de la Baie d’Hudson, ont joué un rôle décisif dans la conquête de ce qui constitue aujourd’hui le Canada. Plus au sud, la Casa de Contratación réglementait et supervisait l’ensemble du commerce et des expéditions vers l’Espagne.
Ces compagnies reflétaient les intérêts impériaux de leurs États d’origine. Initialement, la Compagnie (anglaise) des Indes orientales était principalement motivée par les bénéfices commerciaux. Cependant, en raison des rivalités croissantes entre l’Angleterre, la France et les Pays-Bas, elle a adopté à la fin du XVIIIe siècle un rôle plus agressif dans l’acquisition et la gestion impériale [7]. De même, le roi Louis XIV de France a dissous la Compagnie de la Nouvelle-France en 1663, car il estimait qu’elle ne contrôlait pas suffisamment la colonie et aurait dû faire davantage d’efforts pour y envoyer plus de colons français [8]. Ces compagnies coloniales poursuivaient donc, non seulement des objectifs commerciaux, mais aussi les ambitions des États, mêlant intérêts privés et impériaux, commerce et guerre.

Des canonnières aux tribunaux d’arbitrage
Les États étaient déterminés à protéger les biens étrangers, les investissements et le « droit » au commerce de leurs citoyens, par le biais de l’action diplomatique. Dans son ouvrage, Le droit des gens, publié en 1758, le juriste suisse Emer de Vattel conclut que tout préjudice infligé à un citoyen à l’étranger était une offense envers l’État, justifiant ainsi le recours à la force pour obtenir réparation intégrale ou punir l’agresseur. Les Européens considéraient également comme « hostile » tout pays non européen qui refusait de commercer avec eux ou d’accorder aux étrangers le droit de mener des activités commerciales sur leur territoire. Ces idées ont jeté les bases des doctrines de protection des investissements étrangers à la fin du XVIIIe siècle, et du droit international de l’investissement au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
L’expansion coloniale exigeait la protection du commerce et des biens détenus par des étrangers, car le contrôle des ressources et des richesses était essentiel à la puissance économique et à la croissance industrielle de l’Europe. Dans les colonies, les litiges étaient réglés en faveur des colons ayant réalisé des investissements, grâce au droit impérial. Ainsi, des juges belges, britanniques ou français siégeaient souvent dans les tribunaux de commerce locaux pour résoudre les différends commerciaux et les litiges liés aux investissements. Dans d’autres régions, le recours à la force était un autre moyen de protéger les intérêts commerciaux et les investissements, un processus connu sous le nom de « diplomatie de la canonnière », qui aboutissait généralement à l’imposition d’un traité inégal à l’État non européen.
Les traités inégaux, également appelés traités de capitulation, peuvent être considérés comme les précurseurs des accords de libre-échange, dans la mesure où ils étaient essentiels à la réalisation des ambitions commerciales européennes. Ces instruments juridiques unilatéraux étaient utilisés par les puissances coloniales pour garantir que leur « liberté de commerce » était un droit reconnu et juridiquement contraignant à l’échelle internationale, justifiant ainsi le recours à la force en cas de non-respect.
Les différends commerciaux et relatifs à la propriété étrangère, dans le contexte colonial, étaient bien plus qu’une simple affirmation de pouvoir. Ces questions impliquaient aussi la suprématie de la juridiction et la création de régimes juridiques fondés sur des conceptions européennes de la propriété, de la richesse privée, de l’économie et de la réglementation. Les perceptions européennes des terres colonisées et de leurs habitants étaient influencées par le contexte d’invasion et d’expansion militaire. Cela se reflétait également dans le droit international qui en découlait. Mais les populations locales n’ont jamais pu invoquer ces règles du droit international pour remédier aux dommages et aux souffrances causés par l’extraction impériale des ressources et le déplacement des communautés indigènes. Cette réalité persiste encore aujourd’hui dans la manière dont les investissements étrangers sont réglementés dans les pays du Sud global, sans tenir compte des griefs des communautés locales [9].
Un exemple frappant de cette dynamique est la première guerre de l’opium entre 1839 et 1842. La Grande-Bretagne a envoyé une expédition militaire, soutenue par des mercenaires de la Compagnie des Indes orientales, pour s’opposer à l’interdiction de l’opium imposée par la Chine. Les autorités chinoises étaient préoccupées par les problèmes sanitaires et sociaux causés par cette drogue, dont une grande partie était vendue par la compagnie britannique. La défaite de la Chine a entraîné la cession de Hong Kong à la Couronne britannique, l’octroi d’avantages aux commerçants britanniques et l’établissement du principe d’extraterritorialité, permettant aux citoyens britanniques d’être jugés par des tribunaux britanniques plutôt que chinois. De plus, la Chine a dû payer une énorme amende à titre de compensation pour l’opium détruit [10].
Les États-Unis, qui n’étaient pas une puissance coloniale au sens strict, ont adopté une autre approche. Ils ont mis l’accent sur la protection des intérêts commerciaux de leurs citoyens à travers des traités et à la diplomatie, avec la menace de la force toujours en toile de fond [11]. Toutefois, les États-Unis ont également mobilisé leur marine à plusieurs reprises, comme lors de l’intervention au Honduras en 1905 et des guerres de la banane en Amérique centrale et dans les Caraïbes, au début du XXe siècle. Parallèlement, ils ont cherché à externaliser la protection des investissements de leurs citoyens en recourant à des tribunaux internationaux et en établissant une norme minimale de traitement garantissant un traitement juste et équitable, ainsi que la sécurité totale de leurs ressortissants. Des tribunaux ad hoc ont été mis en place pour résoudre les différends, en utilisant les normes privilégiées par les États-Unis, et fondées sur des principes juridiques américains. Ce point de vue a rencontré des résistances, en particulier en Amérique latine, où la doctrine Calvo soutenait que les citoyens étrangers devaient être traités de la même manière que les citoyens du pays où ils exerçaient leurs activités, et être ainsi jugés par les tribunaux nationaux en cas de litige. Cependant, en tant que puissance régionale dominante, les États-Unis ont imposé leur point de vue aux autres États [12].
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les contrats de concession sont devenus un autre instrument d’imposition des systèmes juridiques occidentaux. Ils étaient couramment utilisés dans les colonies et les protectorats pour réglementer les investissements. Ces contrats accordaient généralement des droits exclusifs à des entreprises privées, ou à des particuliers, pour l’extraction de ressources, telles que les minéraux et l’agriculture, ainsi que pour d’autres activités économiques, comme la construction d’infrastructures et l’exploitation de systèmes de transport. En retour, les puissances coloniales recevaient une part des bénéfices réalisés par ces entreprises. Les entreprises étaient généralement protégées par les lois de leur pays d’origine, ainsi que par sa puissance militaire. De plus, tout comme dans le droit international de l’investissement actuel, les investisseurs étrangers bénéficiaient de nombreux droits sans avoir d’obligations. Au fil du temps, les communautés locales ont critiqué ces contrats en raison de leur impact négatif sur l’environnement et les moyens de subsistance locaux, et du fait que tous les bénéfices allaient aux colonies sans en profiter aux communautés locales. En outre, ces contrats étaient généralement conclus pour des durées très longues, garantissant ainsi la rentabilité des investissements étrangers. Par exemple, la concession Ashanti Goldfields en Côte d’Or (aujourd’hui le Ghana) a été signée en 1895 pour une durée de cent ans.
Avec l’accession à l’indépendance des colonies, les contrats de concession ont ouvert la voie à de nouveaux contrats d’investissement, comprenant des dispositions qui sont encore largement utilisées de nos jours. Par exemple, les clauses de stabilisation contraignaient les États à s’abstenir d’utiliser leurs pouvoirs législatifs ou administratifs de manière préjudiciable aux investissements. En cas de litige, l’arbitrage entre les investisseurs et les États était prévu. Ce type d’arbitrage contournait les tribunaux locaux et témoignait de la capacité d’individus à établir des systèmes réglementaires, dans le cadre du droit international, qui servaient leurs intérêts. En ce sens, il préfigurait l’arbitrage prévu dans les traités d’investissement qui allait émerger quelques années plus tard.
Les investissements étrangers après la Seconde Guerre mondiale
La fin du colonialisme a marqué un véritable tournant. Les investisseurs étrangers se sont retrouvés face à un défi de taille : ils ne pouvaient plus se reposer sur le droit colonial ou les interventions armées pour protéger leurs intérêts. Dans les nouveaux États indépendants, la protection de leurs actifs devenait un enjeu majeur. Les pays africains et asiatiques, conscients que la colonisation avait contribué, d’une part, à leur sous-développement, et d’autre part, à la prospérité de l’Europe, considéraient que c’était à eux de contrôler pleinement leurs ressources nationales et les investissements étrangers. Ils adoptèrent ainsi le point de vue des pays d’Amérique latine, affirmant que les litiges devaient être résolus par les tribunaux nationaux. Cette nouvelle donne reflétait leur détermination à rééquilibrer les rapports de force économiques.
Les entreprises des anciennes puissances coloniales et leur allié américain s’y opposaient catégoriquement. Ils affirmaient que l’État de droit était inexistant dans ces territoires. Selon eux, leurs investissements devaient bénéficier d’une protection contre l’expropriation, c’est-à-dire la saisie de leurs biens privés par le gouvernement, au nom de l’intérêt public. Ils revendiquaient la primauté de tribunaux d’arbitrage prétendument neutres, appliquant le droit international, pour régler ces questions.
Cependant, rendre les décisions d’arbitrage exécutoires était une première étape à franchir. Depuis des décennies, les tribunaux d’arbitrage résolvaient les différends liés aux investissements étrangers découlant de contrats. Mais les investisseurs ne disposaient pas d’un accord international largement reconnu, qui garantissait la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères dans d’autres pays. Ainsi, l’application de ces sentences représentait un défi en soi.
La Chambre de commerce internationale, dont le tribunal d’arbitrage était beaucoup utilisé, a pris l’affaire en main. Elle a rédigé une convention et exercé des pressions sur les Nations unies pour qu’elles l’adoptent. La Convention de New York, officiellement connue sous le nom de Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, a donc été signée en 1958, avec quelques modifications mineures par rapport au texte original. Concrètement, cela signifiait que les sentences arbitrales pouvaient franchir les frontières et que les investisseurs étrangers pouvaient demander à un tribunal de n’importe quel pays signataire d’exécuter la décision [13]. Par exemple, en 2012, Achmea, une compagnie d’assurance néerlandaise, a poursuivi la Slovaquie suite à la décision de l’État de revenir sur la privatisation du système de santé national. Un tribunal d’arbitrage lui a accordé une compensation de 22 millions d’euros [14] . Face au refus de la Slovaquie de payer, Achmea a pu saisir 29,5 millions d’euros d’actifs de l’État d’Europe centrale se trouvant dans des banques luxembourgeoises, en intentant une action devant un tribunal local [15] .
L’idée d’un instrument mondial de protection des investissements faisait son chemin. Deux personnalités du monde des affaires se sont lancées dans la rédaction d’une convention sur l’investissement étranger, s’inspirant des traités américains d’amitié, de navigation et de commerce [16]. Né en 1902, à une époque où l’Empire britannique était à son apogée, Hartley Shawcross était un juriste qui avait également poursuivi une carrière d’administrateur au sein de grandes sociétés, dont la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell. Après la guerre, il avait participé à plusieurs arbitrages pétroliers et était profondément préoccupé par la protection des capitaux privés étrangers dans les pays nouvellement indépendants. Son partenaire, Hermann Abs, un banquier allemand, avait occupé des postes de haut niveau à la Deutsche Bank sous le régime nazi, et avait ainsi joué un rôle clé dans la confiscation des biens juifs au profit des Allemands non juifs. Après la guerre, Abs a été témoin des expropriations massives des biens allemands orchestrées par les Alliés, avant de réintégrer la Deutsche Bank à la fin des années 1950. La rédaction d’un texte commun est arrivée à point nommé, car la protection des investissements étrangers revenait à l’ordre du jour en Allemagne, les entreprises nationales retrouvant la possibilité d’opérer à l’étranger [17].
Malgré son rejet par la plupart des pays occidentaux, leur convention allait jouer un rôle clé dans la formation future de la protection des investissements étrangers. De nombreux aspects controversés, tels que le traitement juste et équitable et la notion d’expropriation indirecte, allaient trouver leur place dans les traités modernes de libre-échange et d’investissement. Les règles purement procédurales de cette convention serviraient de modèle à la Convention CIRDI de 1965.
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), partie intégrante de la Banque mondiale, est le tribunal d’arbitrage le plus utilisé pour les litiges entre investisseurs et États en vertu d’accords de libre-échange et d’investissement. En 1965, la convention régissant ses procédures d’arbitrage fut signée [18]. Pendant les négociations, quatre conférences régionales distinctes furent organisées, mais sans interaction entre elles. Les pays d’Asie et d’Afrique ignoraient, par exemple, des réserves similaires émises par d’autres nations, suggérant ainsi que la Banque mondiale anticipait une éventuelle opposition. Bien que le CIRDI ait initialement été créé pour régler les différends contractuels, son secrétariat incita de nombreux pays occidentaux à inclure une référence au CIRDI dans leurs traités d’investissement [19]. Au fil du temps, le CIRDI a suscité de vives controverses de la part des pays du Sud et des mouvements de la société civile à travers le monde. Les critiques portaient sur le manque de transparence des cours d’arbitrage, le peu d’attention accordé à la protection de la santé et de l’environnement, ainsi que la partialité des arbitres en faveur des investisseurs [20]. En conséquence, la Bolivie et le Venezuela se retirèrent en 2012.
Cependant, jusqu’à la fin des années 1980, les traités d’investissement n’engendrèrent aucun litige entre investisseurs et États. Ces premiers accords étaient relativement limités et manquaient de dispositions strictes. L’Allemagne fut la première à signer quelques traités après 1959, mais sans prévoir de mécanisme d’arbitrage. Le traité entre l’Indonésie et les Pays-Bas, signé en 1968, marqua la première mention du CIRDI. Ce n’est qu’à l’aube des années 1990 que la situation évolua. La chute de l’empire soviétique, l’avènement du néolibéralisme et du consensus de Washington ont donné naissance à un nouveau monde pour les entreprises occidentales.
La troisième partie examine la manière dont les pratiques actuelles de libre-échange reflètent leur héritage colonial.
Footnotes:
[1] Miles, K., “International investment law: origins, imperialism and conceptualizing the environment”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 21, no. 1, pp. 1-48, 2010
[2] Gong, G., The standard of ’civilization’ in international society, Clarendon Press, 1984
[3] Merrills, J. G. “Francisco de Vitoria and the Spanish conquest of the new world”, Irish Jurist , vol. 3, no. 1, pp. 187–194, 1968
[4] Sornajah, M., Resistance and change in the international law on foreign investment, Cambridge University Press, 2015
[5] “America and West Indies: September 1672”, in Sainsbury, N. (ed.), Calendar of state papers colonial, America and West Indies: Volume 7, 1669-1674, pp. 404-417, British History Online, 1889, http://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/america-west-indies/vol7/pp404-417
[6] Sornajah, M., Resistance and change in the international law on foreign investment, Cambridge University Press, 2015
[7] Miles, K., “International investment law: origins, imperialism and conceptualizing the environment”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 21, no. 1, pp.1-48, 2010
[8] Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d’État du roi, concernant le Canada, P.E. Desbarats, 1803
[9] Miles, K., “International investment law: origins, imperialism and conceptualizing the environment”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 21, no. 1, pp.1-48, 2010
[10] La France a utilisé la même stratégie. Un exemple courant est la Guerre des Pâtisseries de 1838. La flotte française fut envoyée sur les côtes mexicaines et captura le grand port de Veracruz après de nombreuses plaintes d’investisseurs français au Mexique. Quelques mois plus tard, un traité de paix fut signé. Il stipulait que le Mexique devrait verser une indemnisation de 600 000 pesos, une somme considérable à l’époque, et que les deux pays entameraient des négociations pour un accord commercial.
[11] Subedi, S., International investment law: reconciling policy and principle, Hart Publishing, 2008
[12] Sornajah, M., Resistance and change in the international law on foreign investment, Cambridge University Press, 2015
[13] La Convention de New York comptait 24 signataires à l’origine et en compte aujourd’hui 168.
[14] “Achmea v. Slovakia (I)”, UNCTAD , https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/323/achmea-v-slovakia-i-
[15] “Slovak assets seized in dispute between state and Achmea”, The Slovak Spectator, 24 May 2013, https://www.bilaterals.org/?slovak-assets-seized-in-dispute
[16] Depuis leur indépendance jusqu’aux années 1960, les États-Unis ont signé de nombreux traités d’amitié, de commerce et de navigation. Il s’agissait d’accords globaux couvrant le commerce, l’investissement, la propriété intellectuelle et parfois même les droits humains, ainsi que le règlement des différends internationaux. Ils sont souvent décrits comme les précurseurs des traités bilatéraux d’investissement.
[17] Alschner, W., “Americanization of the BIT universe: the influence of friendship, commerce and navigation (FCN) treaties on modern investment treaty law”, Goettingen Journal of International Law, vol. 5, no. 2, pp. 455-486, 2013; Bonnitcha, J., Poulsen, L., and Waibel, M., The political economy of the investment treaty regime, Oxford University Press, 2017; James, H., The Deutsche Bank and the Nazi economic war against the Jews: the expropriation of Jewish-owned property, Cambridge University Press, 2001
[18] La Convention comptait 20 signataires à l’origine et 153 aujourd’hui.
[19] Sornajah, M., Resistance and change in the international law on foreign investment, Cambridge University Press, 2015; St John, T., “The creation of investor–State arbitration”, in Schultz, T. and Ortino, F., (eds.), The Oxford handbook of international arbitration, Oxford University Press, 2020
[20] Gómez, K., “Latin America and ICSID: David versus Goliath?”, Law And Business Review Of The Americas, vol. 17, no. 2, pp. 195-230, 2011